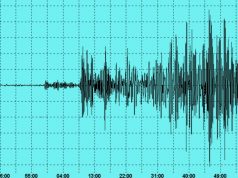La crise actuelle ne peut plus être analysée comme une simple querelle de personnes ou une séquence transitoire mal gérée.
Nous sommes face à un problème de structure de pouvoir illégitime, opaque et dangereusement concentrée, dont les effets deviennent potentiellement irréversibles à partir du 7 février, date à laquelle le mandat du CPT arrive formellement à expiration. À compter de cette date, tout maintien de l’exécutif hors d’un cadre de légitimité renouvelée ne relèvera plus de l’ambiguïté politique, mais d’un vide institutionnel assumé. Il faut poser les choses sans détour. Le poste de Premier ministre est devenu une fonction sans contre-pouvoir, insérée dans une architecture où les mécanismes élémentaires de responsabilité ont disparu. Dans ce contexte, un fait politique majeur s’est imposé dans l’espace public, sans démenti crédible ni clarification institutionnelle : Alix Didier Fils-Aimé a engagé des mercenaires armés, conclu des contrats sécuritaires privés, introduit des technologies de guerre asymétrique, notamment des drones kamikazes, sans contrôle parlementaire, sans mandat populaire, sans transparence, sans cadre juridique clair, et surtout sans responsabilité politique devant la Nation. Ce fait, à lui seul, serait déjà gravissime dans un État fonctionnel.
Dans le contexte haïtien, marqué par l’absence d’État de droit effectif, de justice indépendante, de contrôle démocratique et de séparation réelle des pouvoirs, il devient structurellement explosif. Car lorsqu’un seul individu concentre à la fois : le contrôle de la Police nationale, la coordination d’acteurs armés privés, l’usage de technologies létales, et la définition unilatérale de l’ennemi intérieur, il ne s’agit plus d’une dérive autoritaire graduelle. Il s’agit d’une rupture totale avec le principe de souveraineté populaire. Nous ne sommes plus dans la gouvernance. Nous sommes dans une privatisation de la violence dite légitime, exercée au sommet d’un État déjà délégitimé.
Or, après le 7 février, une question devient incontournable et conditionne toutes les autres : Qui répondra des décisions prises après cette date? Devant quelle instance cette responsabilité pourra-t-elle être engagée, alors que le CPT aura expiré, que le Parlement est absent et que l’appareil judiciaire est structurellement affaibli? Au nom de quel mandat un exécutif pourra-t-il engager des opérations sécuritaires, signer des contrats armés, définir des cibles et administrer la violence d’État? Selon quelle norme juridique, dans quel cadre constitutionnel, avec quelles limites explicites et quels mécanismes de reddition de comptes?
Là réside le cœur du danger. Car après le 7 février, le maintien d’Alix Didier Fils-Aimé produirait un pouvoir de fait, sans fondement constitutionnel ni politique, mais doté de moyens militaires et policiers renforcés. Un exécutif hors-sol, affranchi de toute temporalité démocratique, gouvernant par inertie, par reconnaissance externe et par la force. Ce vide de légitimité ne réduira pas l’ingérence internationale. Il l’amplifiera. Car cette ingérence n’est ni conjoncturelle ni improvisée. Elle est structurelle, intégrée au mode de gestion de la crise haïtienne. Elle prospère précisément sur l’existence d’autorités locales faibles politiquement mais utiles fonctionnellement, capables d’exécuter sans mandat ce que la souveraineté populaire refuserait.
Les puissances étrangères n’imposent pas seules, ce système. Elles l’exploitent parce qu’il existe déjà, parce que des arrangements internes rendent possible la délégation de la souveraineté sécuritaire, la normalisation de l’exception et la substitution du mandat populaire par la simple reconnaissance externe.
Maintenir Alix Didier Fils-Aimé après le 7 février, dans ces conditions, ne stabilisera pas le pays. Cela institutionnalisera le vide, militarisera davantage la crise et rendra toute sortie politique ultérieure plus coûteuse, plus violente et plus incertaine.

Le danger ultime est celui du précédent.
Admettre qu’en Haïti la détention effective de la force armée suffit à assurer la continuité de l’État, même en l’absence totale de mandat, de cadre constitutionnel ou de consentement populaire, revient à poser une règle implicite mais durable : la force comme source de légitimité.
Une fois admis que l’exercice du pouvoir peut se prolonger par simple nécessité sécuritaire, par “réalisme”, par “urgence”, alors plus aucune limite ne tient. Toute transition pourra être indéfiniment prorogée. Toute autorité armée pourra se maintenir au nom de la stabilité qu’elle prétend garantir. Toute exigence démocratique pourra être disqualifiée comme irresponsable face à l’argument de l’ordre. C’est ainsi que les États ne s’effondrent pas brutalement, mais se vident progressivement de leur substance, jusqu’à n’être plus que des dispositifs de gestion coercitive. À ce stade, la question n’est donc plus seulement qui gouverne, mais : qui répond des actes posés, devant quelle autorité, au nom de quel mandat, et selon quelle norme juridique.
Refuser de répondre à ces questions après le 7 février ne sera plus une erreur d’analyse. Ce sera une faute politique majeure, aux conséquences potentiellement irréversibles pour la souveraineté, la sécurité et l’avenir même de l’État haïtien.
Un État affranchi du peuple, mais armé. Un exécutif sans mandat, mais doté de technologies létales. Une sécurité sans droit, sans contrôle, sans limite politique. Il faut enfin nommer le dernier danger, souvent éludé parce qu’il dérange autant les acteurs internes que les partenaires externes. Ce n’est pas une transition prolongée, mais une mutation autoritaire silencieuse, rendue possible par l’effondrement préalable des contre-pouvoirs et par l’acceptation résignée de l’exception comme norme.
À ce stade, il faut être clair. Défendre le maintien d’Alix Didier Fils-Aimé après le 7 février au nom de la stabilité, ce n’est pas sauver l’État. C’est entériner sa dénaturation. En résumé, écarter un homme ne suffit pas à résoudre une crise structurelle. Mais laisser un homme concentrer un tel pouvoir coercitif, dans un vide institutionnel assumé, revient à transformer une crise politique en point de non-retour historique.
Haïti n’est pas au bord du chaos. Haïti est au bord de la normalisation du vide politique armé. Et c’est précisément ce basculement qu’il faut empêcher!
Kervens Louissaint